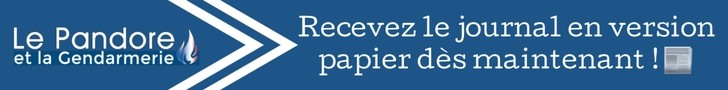Dans les Alpes, les secouristes sonnent l’alarme. Depuis quelques années, ils sont confrontés à une recrudescence de fausses alertes envoyées par des montres et téléphones connectés, censés sauver des vies. Ces dispositifs, capables de prévenir automatiquement les secours via satellite en cas de chute ou d’accident, se déclenchent parfois… sans raison. Une situation qui coûte cher et mobilise inutilement des moyens précieux.
Une technologie bienveillante, mais parfois envahissante
Montres Garmin, iPhone récents, smartphones Android dernière génération… Ces appareils sont désormais nombreux à intégrer un système de détection de chute. Le principe est simple : en cas de décélération brutale ou de mouvement anormal, l’appareil envoie une alerte avec la localisation GPS de son propriétaire. Et si ce dernier ne confirme pas rapidement qu’il va bien, un centre de secours est automatiquement prévenu.
Sur le papier, cette fonctionnalité représente une véritable avancée pour la sécurité des randonneurs. Mais sur le terrain, le constat est plus nuancé. « Nous recensons une dizaine de fausses alertes par an, et ce chiffre augmente », explique Cyril Gomez, secouriste au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie.
Des interventions déclenchées pour rien
Début août, le PGHM reçoit ainsi une alerte automatique près du lac de La Plagne. Comme toujours, les secouristes tentent d’abord de joindre la personne par téléphone. Sans réponse – souvent faute de réseau – ils décident d’intervenir. Un hélicoptère est dépêché sur place. À l’arrivée, la scène prête presque à sourire : un groupe de randonneurs surpris, tous en parfaite santé. La montre connectée de l’un d’entre eux avait simplement interprété une petite glissade comme un accident sérieux.
Si l’anecdote peut sembler légère, ses conséquences ne le sont pas. L’hélicoptère mobilisé aurait pu être requis pour une véritable urgence. Et chaque minute de vol a un prix.
« 80 euros la minute »
« Un hélicoptère de gendarmerie, c’est 80 euros la minute », rappelle Cyril Gomez. « Ce ne sont pas des interventions gratuites, elles sont financées par les impôts. » Au-delà du coût financier, il y a aussi un coût opérationnel : chaque fausse alerte détourne des moyens humains et matériels qui pourraient sauver une vie ailleurs.
C’est pourquoi les secouristes insistent : il est essentiel que les utilisateurs de ces appareils apprennent à gérer leurs fonctionnalités. Lorsqu’une notification s’affiche signalant l’imminence d’un appel aux secours, il faut y répondre. Et si l’alerte est envoyée par erreur, un simple coup de fil au PGHM permet d’interrompre les recherches.
Entre progrès et responsabilité
Personne ne remet en cause l’utilité de ces technologies. Dans les zones isolées, où le réseau mobile est inexistant, elles ont déjà fait la différence entre la vie et la mort. Le problème ne vient donc pas des outils eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont utilisés.
« Ces systèmes sont formidables lorsqu’il y a un véritable accident », souligne Cyril Gomez. « Mais il faut que chacun comprenne que la montagne n’est pas un terrain de jeu sans conséquence. Une alerte satellite n’est pas un bouton d’appel banal, elle mobilise de lourds moyens. »
Un appel à la vigilance des randonneurs
Pour les secours en montagne, le message est clair : les randonneurs doivent faire preuve de responsabilité. Avant de partir, il est utile de se renseigner sur le fonctionnement de son appareil et d’apprendre à reconnaître ses alertes. Pendant l’excursion, rester attentif aux notifications permet d’éviter des déclenchements intempestifs. Et en cas de doute, un simple appel aux secours pour signaler que tout va bien évite de coûteuses erreurs.
Au final, la technologie offre aux randonneurs une sécurité inédite, mais elle ne remplacera jamais la vigilance humaine. Dans les grands espaces, un geste aussi simple que vérifier sa montre ou son téléphone peut faire la différence… non seulement pour soi, mais aussi pour ceux qui comptent sur la disponibilité des secours.